Naissance d’une vocation
« Mes parents, mes frères et mes sœurs étaient loin, plongés dans un univers normal que l’infirmité m’interdisait. Je lisais…« . Dans un livre d’entretiens publié en 1970, Alberto Moravia (de son vrai nom Alberto Pincherle) explique comment sa vocation d’écrivain lui est venue par la lecture, malgré ou à cause d’une enfance fracassée. Un exemple de « résilience« , de résistance à l’adversité. Un comportement popularisé par le neurologue Boris Cyrulnik. Tout au long de sa vie, Alberto Moravia cultivera son goût pour l’écriture. D’abord, dès l’enfance, il écrira de la poésie, des nouvelles, puis dans sa vie d’adulte, des romans, des pièces de théâtre, des essais, des articles de revues, des critiques de films… Romancier, auteur dramatique, scénariste, journaliste, Alberto Moravia, par son talent d’écriture, gagnera la célébrité internationale. Pour ses lecteurs d’aujourd’hui, Moravia reste un irremplaçable témoin oculaire d’un XXe siècle dont nous subissons encore aujourd’hui les conséquences de son histoire tragique.
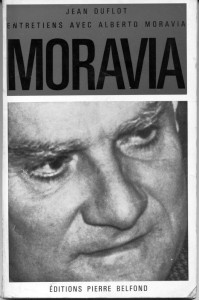
Alberto était né à Rome dans une famille de la petite bourgeoisie italienne. Son père, architecte d’un certain renom, était aussi peintre amateur. Cette activité artistique de création et de réalisation, très accaparant, comme le savent tous ceux qui exercent une profession libérale. C’était un personnage taciturne, distant, secret. Le jeune Alberto avait dû percevoir douloureuse-ment le manque d’autorité de ses parents en raison de son affectivité et d’une sensibilité sans doute plus développée chez lui que chez ses trois frères et sœurs.
Dès son plus jeune âge, par trop livré à lui-même, le jeune Alberto raconte que, du fait de cette disponibilité, le démon de la lecture s’était emparé de lui. Comme ses parents voulaient le destiner à la carrière diplomatique, il avait eu très tôt des gouvernantes qui lui avaient appris le français qu’il avait su parler avant l’italien, puis aussi l’allemand, l’anglais… Cependant, n’ayant pratiquement jamais fréquenté l’école, Alberto Moravia avait pris conscience de ce que représente l’enfance : une période marquée par l’incapacité de choisir, l’impuissance d’agir, l’aliénation, puisque ce sont les autres, les adultes, qui décident de choses importantes pour la vie future de l’enfant.
C’est toute la difficulté du passage de l’enfance à l’âge adulte, gouffre que certains n’arrivent jamais à franchir. L’enfant doit subir un choc, supporter une rupture, surmonter des contraintes afin de découvrir et d’assimiler « la règle du jeu » (1) de la vie. C’est pourquoi, l’imagination stimulée par sa boulimie de lecture, le jeune Alberto Moravia avait fait le choix de la littérature. Il exploitera le seul gisement mental qui lui était offert : la réalité de l’enfance.
Première contrainte, la maladie
À neuf ans, Alberto Moravia avait commencé à souffrir des premiers symptômes d’une maladie grave, la tuberculose osseuse. Elle allait le contraindre à vivre alité pendant près d’une dizaine d’années, de 1916 à 1925. La solitude, la maladie, son absence de scolarité, avaient été autant de circonstances qui n’ont fait que renforcer sa timidité maladive. Cet adolescent plongé dans l’irréalité se sentira incapable de développer des rapports normaux avec « les autres« . Moravia explique que cette maladie avait été, sinon occasionnée, du moins favorisée par une sorte d’affection psychosomatique, une crise existentielle, provoquée par un certain dégoût de vivre.
En raison de sa sensibilité exacerbée, les parents d’Alberto lui avaient interdit de lire des livres d’aventures. Il s’était rabattu sur des ouvrages psychologiques et des pièces de théâtre. À 16 ans, à la suite d’une rechute de sa maladie, ses parents décident de l’envoyer, plâtré, dans un sanatorium de montagne à Cortina d’Ampezzo. Il y restera immobilisé pendant près de deux ans, de 1923 à 1925. Abonné à une bibliothèque tournante de Florence, il recevait chaque semaine un gros colis de livres. Il les dévorait au rythme d’un par jour. C’est ainsi qu’il a fait la découverte de Shakespeare, de Molière et de Marivaux, dramaturges contemporains de l’italien Goldoni, auteur de près de 200 comédies et tragédies et aussi de Rimbaud, Manzoni, Dostoïevski, Gogol, Stendhal, Alexandre Dumas, Proust…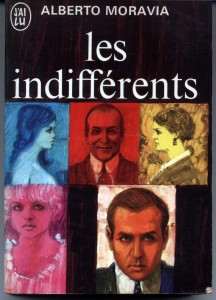
Ces circonstances ont valu au jeune Alberto de parcourir, inconsciemment, les étapes de la création littéraire, la contemplation, le rêve, l’imaginaire, la volonté créatrice. Le goût de raconter des histoires le fera s’exprimer d’abord verbalement, puis ensuite en mettant noir sur blanc, sans ponctuation, un texte qu’il relisait à haute voix, sensible à la succession des phrases comme une musique dont il réglait le rythme à l’oreille. Sa fréquentation des grands auteurs lui avait permis de trouver ses moyens d’expression. Par exemple, chez Manzoni, le goût de la narration, chez Rimbaud, le sens de la révolte, chez Goldoni, la technique théâtrale du dialogue.
En octobre 1925, juste avant l’anniversaire de ses dix huit ans, Alberto Moravia sort du sanatorium avec des béquilles et un plâtre orthopédique. Il refuse de suivre les conseils de sa mère qui souhaitait vivement le voir reprendre des études. Il prend le risque de se placer en marge de la vie normale. Il s’installe près de Cortina d’Ampezzo et commence à écrire un roman. Il le terminera deux ans plus tard. Le roman ne sera publié qu’en 1929 à compte d’auteur sous le titre « Les Indifférents« . Car tous les éditeurs sollicités avaient refusé de publier cet inconnu dont ils qualifiaient le manuscrit de « brouillard de paroles« . En désespoir de cause, Alberto avait demandé et obtenu de son père qu’il veuille bien prendre en charge les frais d’édition de son premier roman.
Les parcours analogues de Proust, Malraux, Sagan
« Qu’est-ce qu’un grand écrivain sinon celui qui trouve un sujet« . Jean-François Revel nous l’affirme dans son essai « Su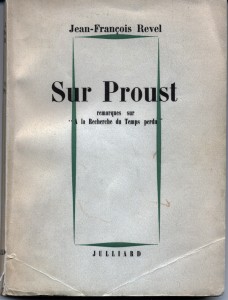 r Proust » publié en 1960. Le sujet deProust, c’est l’apparition des aspects de l’homme qu’il décrit. Pour un auteur comme pour
r Proust » publié en 1960. Le sujet deProust, c’est l’apparition des aspects de l’homme qu’il décrit. Pour un auteur comme pour 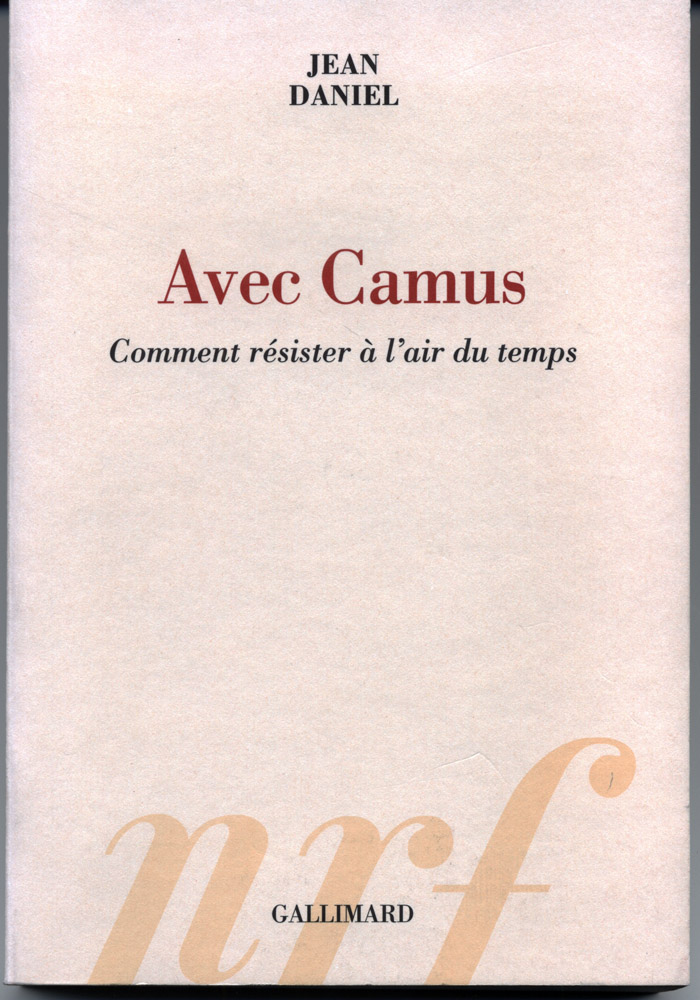 un éditeur, il faut avoir « du flair« , un talent qui permet de trouver son sujet, de » saisir « , c’est-à-dire à la fois de comprendre et de s’emparer de ce qui flotte dans « l’air du temps« . Ensuite, on peut adhérer ou résister aux concepts, aux idées, voire aux idéologies de son temps, mais à condition de posséder les moyens d’exprimer sa pensée et de la diffuser auprès du plus grand nombre. Jean Daniel montre cela dans « Avec Camus – Comment résister à l’air du temps« , un livre publié en 2006. On y trouve une réflexion superbe : « La violence est à la fois inévitable et injustifiable et la fin ne justifie jamais les moyens. Avec ces deux principes, il faut s’inventer à chaque moment un comportement« .
un éditeur, il faut avoir « du flair« , un talent qui permet de trouver son sujet, de » saisir « , c’est-à-dire à la fois de comprendre et de s’emparer de ce qui flotte dans « l’air du temps« . Ensuite, on peut adhérer ou résister aux concepts, aux idées, voire aux idéologies de son temps, mais à condition de posséder les moyens d’exprimer sa pensée et de la diffuser auprès du plus grand nombre. Jean Daniel montre cela dans « Avec Camus – Comment résister à l’air du temps« , un livre publié en 2006. On y trouve une réflexion superbe : « La violence est à la fois inévitable et injustifiable et la fin ne justifie jamais les moyens. Avec ces deux principes, il faut s’inventer à chaque moment un comportement« .
On ne peut pas, non plus, ne pas comparer le parcours de Marcel Proust (1871-1922), ce géant de la littérature du XXe siècle, à celui de Moravia. Proust a souffert, dès son enfance, de crises d’asthme répétées et sera obligé de vivre pratiquement cloîtré. Cette contrainte le conduira à se consacrer à l’écriture. En 1913, il devra publier, à compte d’auteur lui aussi, le premier volume de « À la recherche du temps perdu« , son manuscrit ayant été sèchement écarté par le jeune André Gide, lecteur chez Gallimard. Il fut aussi renvoyé à son auteur par l’éditeur Ollendorf. Dans la lettre d’accompagnement, un jugement définitif est resté célèbre : « Je suis peut-être bouché à l’émeri, mais je ne puis comprendre qu’un monsieur puisse employer trente pages à décrire comment il se tourne et se retourne dans son lit avant de trouver le sommeil » ! C’est ainsi que le directeur de la maison d’édition justifiait son refus de publier la première partie de « Du côté de chez Swann« .
En revanche, en 1954, le « flair » de l’éditeur René Julliard lui permit d’être le premier à prendre contact avec Françoise Sagan(1935-2004) pour faire signer par ses parents un premier contrat d’édition. À cette époque la majorité était fixée à vingt et un ans. La jeune fille avait envoyé, à dix huit ans, sans trop y croire, le manuscrit de « Bonjour tristesse » à plusieurs éditeurs. De son vrai nom Françoise Quoirez, Sagan (pseudonyme choisi parmi les personnages aristocratiques de Proust) publiera de nombreux romans, pièces de théâtre et scénarios. « Bonjour tristesse » obtint un succès énorme, car il annonçait, dix ans à l’avance, le rejet par la jeunesse d’une société archaïque (Cf. Henri Mendras « La seconde révolution française 1965-1984 » ) et le fantasme d’une nouvelle liberté des moeurs. Ce premier roman consacrera une romancière qui figure désormais parmi les plus célèbres auteurs du XXesiècle.
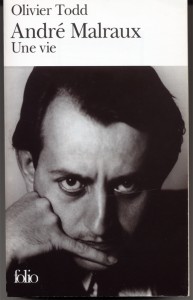 Autre parallèle frappant : André Malraux (1901-1976). Ses parents s’étant séparés en 1905, ce fut un grand choc dans la vie de l’enfant. Victime du SGT (Syndrome Gilles dela Tourette), il ne put fréquenter l’école primaire, car il était dévoré de tics. À quatorze ans, il entrera à l’école de la rue Turbigo, période durant laquelle il fréquente les bouquinistes, les milieux artistiques de Paris, les salles de cinéma, de théâtre, d’expositions, de concerts. Il abandonne ses études secondaires et n’obtiendra jamais son baccalauréat. Il se passionnera pour la littérature et publiera ses premiers textes dès 1920.
Autre parallèle frappant : André Malraux (1901-1976). Ses parents s’étant séparés en 1905, ce fut un grand choc dans la vie de l’enfant. Victime du SGT (Syndrome Gilles dela Tourette), il ne put fréquenter l’école primaire, car il était dévoré de tics. À quatorze ans, il entrera à l’école de la rue Turbigo, période durant laquelle il fréquente les bouquinistes, les milieux artistiques de Paris, les salles de cinéma, de théâtre, d’expositions, de concerts. Il abandonne ses études secondaires et n’obtiendra jamais son baccalauréat. Il se passionnera pour la littérature et publiera ses premiers textes dès 1920.
Il épouse Clara Goldschmidt, riche héritière dont il dilapide rapidement la fortune. Il part en Indochine pour y voler des bas-reliefs et les revendre. Arrêté, il est assigné à résidence à Saigon et, en attente de son procès, André Malraux fonde un journal anticolonialiste. Il tirera de cette expérience la matière de ses premiers romans. D’abord « Les Conquérants » en 1928, dont le succès le fera reconnaitre comme écrivain, puis « La Voie royale » (Prix Interallié) et « La Condition humaine » (Prix Goncourt 1933). Il continuera à publier et se forgera une carrière d’homme d’action (Guerre d’Espagne et Résistance française), puis d’homme politique, notamment comme ministre de la culture du général de Gaulle.
À l’occasion de la publication en 1955 dans La Pléiade de ses trois romans, les Conquérants, la Condition humaine et l’Espoir, André Malraux, dans la postface qu’il place à la suite des Conquérants, reprend un discours fait à ses compagnons gaullistes en mars 1948. Il écrit : « Plus de vingt ans ont passé depuis la publication de ce livre d’adolescent… Mais ce livre n’appartient que bien superficiellement à l’Histoire. S’il a surnagé, ce n’est pas pour avoir peint tels épisodes de la révolution chinoise, c’est pour avoir montré un type de héros en qui s’unissent l’aptitude à l’action, la culture et la lucidité« . Voilà ce qui confirme de façon éclatante que la lecture et donc la culture, constituent un parcours obligé pour conférer à « CEUX QUI… » veulent agir, à ceux qui veulent écrire, la lucidité et la capacité de jugement requises par la complexité des situations.
Une autre maladie va frapper Moravia : le fascisme
En 1921, le Parti National Fasciste (PNF) de Mussolini présentait au peuple italien, un programme polit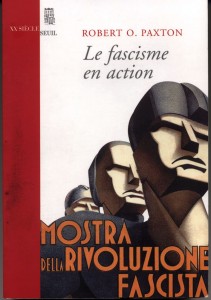 ique nationaliste, autoritaire, antisocialiste et antisyndical. Il aura l’appui de la bourgeoisie et d’une grande partie des classes moyennes industrielles du nord de l’Italie et agraires du sud. Le succès du premier roman d’Alberto Moravia en 1929, rend celui-ci immédiatement suspect d’être un ennemi du fascisme. « Les Indifférents » montraient en effet des personnages en total décalage avec l’idéaltype du mouvement fasciste. Celui-ci doit être composé de personnages sains, exempts d’états d’âme, obéissants à une idéologie de masse destinée à rassembler toute une population confiante dans un seul chef, « le Duce« .
ique nationaliste, autoritaire, antisocialiste et antisyndical. Il aura l’appui de la bourgeoisie et d’une grande partie des classes moyennes industrielles du nord de l’Italie et agraires du sud. Le succès du premier roman d’Alberto Moravia en 1929, rend celui-ci immédiatement suspect d’être un ennemi du fascisme. « Les Indifférents » montraient en effet des personnages en total décalage avec l’idéaltype du mouvement fasciste. Celui-ci doit être composé de personnages sains, exempts d’états d’âme, obéissants à une idéologie de masse destinée à rassembler toute une population confiante dans un seul chef, « le Duce« .
Certes, le régim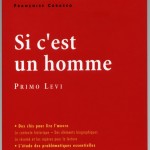 e fasciste italien, n’était pas aussi cruel que le nazisme. Sauf dans les derniers moments de son existence, à la fin des années 1930 et surtout pendant la République de Salo, il ne comportait pas de dimension raciste et antisémite. Ce ne sera le cas qu’à la fin de 1943, à l’exemple de l’arrestation en tant que résistant et juif de l’ingénieur chimiste Primo Levi qui sera déporté à Auschwitz en février 1944. Il pourra en revenir et publiera « Si c’est un homme« , témoignage poignant de son expérience des camps de concentration.
e fasciste italien, n’était pas aussi cruel que le nazisme. Sauf dans les derniers moments de son existence, à la fin des années 1930 et surtout pendant la République de Salo, il ne comportait pas de dimension raciste et antisémite. Ce ne sera le cas qu’à la fin de 1943, à l’exemple de l’arrestation en tant que résistant et juif de l’ingénieur chimiste Primo Levi qui sera déporté à Auschwitz en février 1944. Il pourra en revenir et publiera « Si c’est un homme« , témoignage poignant de son expérience des camps de concentration.
Lorsqu’il a commencé à publier dans les années 1930, Alberto Moravia savait que la littérature était, à cette époque, le moyen d’expression considéré comme le plus puissant. Le personnage de l’écrivain était reconnu comme un témoin crédible, un maître à penser pour l’opinion publique. C’est pourquoi, progressivement, le régime fasciste empêchera Alberto Moravia de publier ses écrits, non seulement ses romans, mais aussi ses articles dans la presse, ses critiques de cinéma. Le régime fasciste italien deviendra pour Alberto Moravia de plus en plus gênant, du fait de l’absence de liberté et par ses décisions arbitraires. Son second roman, « Les ambitions déçues » ne pourra pas être diffusé et Moravia ne pourra plus rien publier entre 1935 et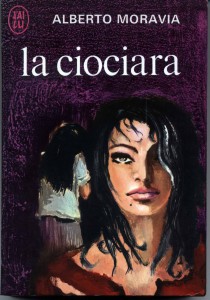 1944.
1944.
La permanence du thème de la sexualité dans ses romans vaudra à l’écrivain Moravia, non seulement l’hostilité du régime fasciste italien, mais aussi, en 1952, sa mise à l’Index par le Vatican. Après s’être exilé en France, en Angleterre et aux USA, il revient en Italie en 1943, à la chute de Mussolini. Comme celui-ci, destitué et emprisonné par le roi Victor Emmanuel III, est délivré par un commando de parachutistes allemands, il crée la République fasciste de Salo. Craignant alors d’être arrêté, Moravia va se cacher dans une ferme proche de Cassino, entre Rome et Naples. Durant les combats de la libération de l’Italie par les forces alliées pendant l’hiver 1943 et le printemps 1944, il y vivra les horreurs de la guerre. Il sera témoin, à 100 km de Rome, de la misère, de la vie autarcique de paysans analphabètes, dépourvus de tout sens social. Cette expérience lui fournira le matériau du drame vécu par une femme accompagnée de sa fille de treize ans qui se veulent se rendre de La Ciociara à Rome. Le roman « La Ciociara » sera publié en 1957, inspiré par les exactions des troupes alliées, notamment celles des tabors marocains, lors de la bataille de Cassino et sera transposé au cinéma avec Sophia Loren dans le rôle principal.
Écrire la vie, écrire sa vie
Le roman « Les Indifférents » fut un succès considérable. Vendu à 5 000 exemplaires, à une époque où les italiens lisaient peu, l’écrivain Alberto Moravia était lancé. Ce roman existentialiste avant la lettre, matérialisait un courant philosophique et littéraire né au XIXe siècle avec les thèses du philosophe danois Søren Kierkegaard (1813-1855) et les romans de Dostoïevski. Ce mouvement sera cultivé par Franz Kafka et développé dans les années 1950 par Jean-Paul Sartre et Albert Camus, puis plus tard, par Milan Kundera.
Dans ce premier roman Moravia mettait en scène cinq personnages : une mère divorcée, son amant, sa meilleure amie, son fils et sa fille. Ces représentants de la moyenne bourgeoisie évoluent dans un univers feutré, impersonnel, superficiel, le monde des « téléphones blancs« , comme on le dira plus tard, lorsque le cinéma mettra à l’écran des situations analogues. La plupart des dialogues s’échangent dans la villa cossue d’un quartier élégant dans une grande ville italienne. Les personnages, individualistes, veules, laids moralement, vivent une sorte d’huis clos existentiel, prémonitoire de la réplique qui termine la pièce de théâtre de Jean-Paul Sartre en 1944, la célèbre chute de Huis clos : « l’Enfer, c’est les autres« .
« Les Indifférents » de Moravia ont des préoccupations centrées essentiellement sur l’argent et sur le sexe. On comprend qu’Alberto Moravia, resté frustré de contacts normaux avec les autres pendant les années de sa maladie, se soit défoulé en laissant libre cours à sa puissante imagination, forte aussi d’une ironie féroce vis à vis de la bourgeoisie conservatrice italienne. D’autre part, on peut se demander pour quelles raisons ce premier roman d’Alberto Moravia, somme toute assez caricatural, ait eu tant de succès lors de sa publication en 1929. L’air du temps voulait sans doute que les lecteurs italiens trouvent dans ce roman le moyen d’échapper à l’ambiance étouffante du régime fasciste de Benito Mussolini. Celui-ci, socialiste à l’origine, créateur du Parti National Fasciste, devenu dictateur en 1924, se rapprochera de l’Allemagne nazie en 1935. Au cours des années 1930, beaucoup d’italiens voulaient oublier dans littérature les humiliations de la guerre 1914-1918 (défaite de Caporetto de 1917), les revendications territoriales non ou mal réglées par le Traité de Versailles (Trieste, Fiume), la menace du bolchevisme (communisme) sur le plan économique et social.
A propos de la présence permanente de la sexualité dans ses romans, Alberto Moravia explique qu’il a commencé à écrire, entre 1910 et 1920, à une période qui a vu l’écroulement des valeurs européennes nées de l’humanisme du siècle des Lumières. La sexualité lui apparaissait alors comme une des seules valeurs dont on pouvait partir, car non périmée. Ce niveau zéro des rapports humains ne pouvait pas être remis en cause. De fait, les années 1930 resteront marquées par l’apparition au grand jour des mœurs homosexuelles masculines et féminines, ce qui sera un des thèmes principaux de Marcel Proust dans « À la recherche du temps perdu » (Sodome et Gomorrhe).
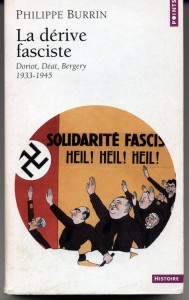
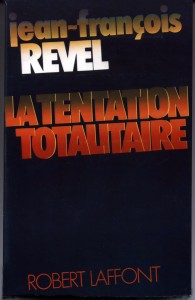 On comprend pourquoi, par réaction contre cet esprit de décadence et aussi par peur du bolchevisme, les milieux conservateurs d’Europe occidentale se soient réfugiés dans les idéologies d’extrême droite, dans une « Tentation totalitaire« , selon le titre d’un livre de Jean-François Revel, voire dans « La dérive fasciste« , ouvrage de l’historien suisse Philippe Burrin. Ce dernier décrit le parcours d’hommes de gauche français, le communiste Jacques Doriot, le socialiste Marcel Déat et le radical Gaston Bergery, qui, à l’image du socialiste Benito Mussolini, vont rejoindre en 1940 le régime de Vichy et collaborer avec l’occupant nazi.
On comprend pourquoi, par réaction contre cet esprit de décadence et aussi par peur du bolchevisme, les milieux conservateurs d’Europe occidentale se soient réfugiés dans les idéologies d’extrême droite, dans une « Tentation totalitaire« , selon le titre d’un livre de Jean-François Revel, voire dans « La dérive fasciste« , ouvrage de l’historien suisse Philippe Burrin. Ce dernier décrit le parcours d’hommes de gauche français, le communiste Jacques Doriot, le socialiste Marcel Déat et le radical Gaston Bergery, qui, à l’image du socialiste Benito Mussolini, vont rejoindre en 1940 le régime de Vichy et collaborer avec l’occupant nazi.
Tout au long de sa vie, Moravia publiera une trentaine de romans dans lesquels il traitera toujours à peu près du même « sujet« , en plaçant dans différents milieux les thèmes qui lui étaient familiers et bien dans l’air de son temps : le problème de l’action, de la difficulté d’agir par rapport à une réalité souvent ignorée, secrète, interdite.
Moravia, ce grand témoin du XXe siècle, est en cela le digne héritier de Machiavel, un des plus remarquables penseurs italiens de la Renaissance. Dans son œuvre, Machiavel entendait montrer la réalité de la société, mettre au jour les hypocrisies de la comédie humaine et, sans illusions sur leurs vertus, décrire les hommes tels qu’ils sont et non pas tels qu’ils devraient être.
Ainsi, Moravia romancier pessimiste développe les thèmes de l’indifférence, de la peur, de l’ennui, de l’aliénation, de l’absurde, de la révolte, de la violence. Il aborde ainsi les problèmes de l’engagement, de la responsabilité, du courage, de la volonté, du sens que l’on souhaite donner à sa vie afin de se forger une personnalité et, le plus souvent, de l’échec de ces tentatives. Le roman est un espace dans lequel l’auteur se raconte, tente d’écrire sa vie. Il écrit pour découvrir ce qu’il doit écrire. Il écrit pour savoir qui il est et pourquoi il vit.
Dostoïevski, l’influence majeure de Moravia
Dostoïevski, le plus grand des romanciers sel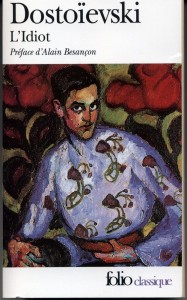 on André Gide, est l’écrivain qui aura eu le plus d’influence sur Moravia. Dostoïevski aura vécu la première partie de sa vie sous le signe de la violence, de l’injustice et des rapports de domination. Sa vie d’adulte se déroulera, elle aussi, sous la malédiction d’une maladie, l’épilepsie. Mort à soixante ans, Dostoïevski (1821-1881) se destinait à être dramaturge. Pourtant, il n’a écrit aucune pièce de théâtre. En réalité, constamment endetté, le besoin d’argent le condamnait à écrire sans arrêt. De même que l’adolescent Moravia alité dans un sanatorium se racontait des histoires à voix haute, Dostoïevski dictait son texte en marchant de long en large. Pour toucher une audience importante de lecteurs, le moyen de l’époque était la publication en feuilleton. Afin d’apporter en temps voulu les feuillets manuscrits à l’éditeur, sa seconde épouse notait en sténo le texte des romans. Faits de dialogues plus que de descriptions, Dostoïevski les imaginait au fur et à mesure, sans suivre de plan général pour son œuvre. Avec environ une dizaine de personnages-types, Dostoïevski nous laissera une analyse en profondeur de la Russie et de ses contemporains : « Crime et châtiment » publié en 1866, « l’Idiot » en 1868, « les Possédés »en 1871 et « les Frères Karamazov » en 1880.
on André Gide, est l’écrivain qui aura eu le plus d’influence sur Moravia. Dostoïevski aura vécu la première partie de sa vie sous le signe de la violence, de l’injustice et des rapports de domination. Sa vie d’adulte se déroulera, elle aussi, sous la malédiction d’une maladie, l’épilepsie. Mort à soixante ans, Dostoïevski (1821-1881) se destinait à être dramaturge. Pourtant, il n’a écrit aucune pièce de théâtre. En réalité, constamment endetté, le besoin d’argent le condamnait à écrire sans arrêt. De même que l’adolescent Moravia alité dans un sanatorium se racontait des histoires à voix haute, Dostoïevski dictait son texte en marchant de long en large. Pour toucher une audience importante de lecteurs, le moyen de l’époque était la publication en feuilleton. Afin d’apporter en temps voulu les feuillets manuscrits à l’éditeur, sa seconde épouse notait en sténo le texte des romans. Faits de dialogues plus que de descriptions, Dostoïevski les imaginait au fur et à mesure, sans suivre de plan général pour son œuvre. Avec environ une dizaine de personnages-types, Dostoïevski nous laissera une analyse en profondeur de la Russie et de ses contemporains : « Crime et châtiment » publié en 1866, « l’Idiot » en 1868, « les Possédés »en 1871 et « les Frères Karamazov » en 1880.
Le cinéma, art populaire à l’époque du muet, puis du parlant, fonctionnait très souvent aussi par épisodes successifs. De la même façon, de nos jours, le grand public peut suivre à la télévision des histoires sous la forme de séries. On se souvient que Jules Verne avait publié en feuilleton, lui aussi dans la seconde moitié du XIXe siècle, les premières éditions de ses « Voyages extraordinaires« . Pas grand-chose de nouveau sous le soleil !
Moravia et le théâtre
Moravia éprouvait pour le théâtre la même passion que pour le roman. Le roman permet d’évoquer la réalité en montrant de nombreux détails avec une précision minutieuse et un fort pouvoir d’évocation. Il permet aussi d’exprimer la durée en jouant avec le facteur temps. Moravia concevait le théâtre comme un moyen d’expression complémentaire, spécifique, surtout dans sa pratique classique avec unité d’action, de temps et de lieu. Avec une certaine économie de moyens, le théâtre est plus symbolique, il permet mieux de faire passer des idées, des idéologies. Sinon, c’est autre chose et cela s’appelle le spectacle vivant. Au contraire de la pièce de théâtre, le roman n’est pas fait pour exprimer des théories. Marcel Proust le confirme dans « Le Temps retrouvé« . Avant d’entrer dans le salon où le narrateur est invité à la matinée Guermantes, les pavés mal équarris de la cour, le choc de la cuillère, la serviette empesée expriment « une réalité, non dans l’apparence du sujet mais dans la profondeur de tous les états successifs qui ont abouti à leur fixation, à leur expression. Ce qui fait que les théoriciens croient pouvoir se passer de la qualité du langage. D’où la grossière tentation pour l’écrivain d’écrire des œuvres intellectuelles. Grande indélicatesse. Une œuvre où il y a des théories est comme un objet sur lequel on laisse la marque du prix« .
Moravia a écrit des pièces de théâtre et ouvert des salles de spectacle en Italie pour les présenter. Mais il regrettait que le théâtre soit un moyen d’expression cher et qui ne permet guère de drainer un public nombreux. C’est pourquoi ses rapports avec le cinéma, moyen d’expression plus populaire et plus international, ont été beaucoup mieux réussis.
Moravia et le cinéma
Moravia aura rédigé quelque 800 critiques de films et le cinéaste Pier Paolo Pasolini aura été son meilleur ami. Il faut reconnaître que les romans de Moravia se prêtent bien à leur transposition au cinéma, un média parfaitement adapté à la (re)création de la vie dans le temps. De plus, Moravia a été particulièrement bien servi par des metteurs de scène de talent et par de grands interprètes. Si on demandait à Alberto Moravia s’il attendait des réalisateurs de films une certaine fidélité à ses romans, il répondait qu’il attendait surtout de voir de bons films . On peut dire que sur ce plan, il n’a pas été trop mal servi.
La marchande d’amour. Drame de Mario Soldati, d’après « La Provinciale » sorti en 1953. Un des meilleurs films italiens des années 1950. Il fera connaître deux grands acteurs Gina Lollobrigida et Franco Interlenghi.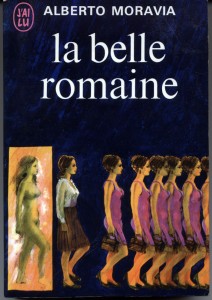
La belle romaine. Mélodrame de Luigi Zampa, d’après « La Romana« , sorti en 1954. Le roman d’une femme victime de sa beauté. Ce sera un des grands rôles de Gina Lollobrigida entourée par Daniel Gélin, Raymond Pellegrin, Franco Fabrizi.
La Ciociara. Drame de Vittorio De Sica de 1960, d’après le roman éponyme de Moravia. Ce film montre la vie difficile du petit peuple italien, comme Moravia l’avait réellement vécue en 1943. Sophia Loren était entourée par Raf Vallone et Jean-Paul Belmondo. Sofia Loren obtint un prix d’interprétation à Cannes en 1961 et un Oscar à Hollywood en 1964, des récompenses qui la consacrèrent dans son statut de star.
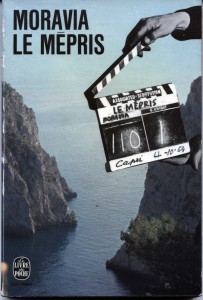 Le mépris. Drame de Jean-Luc Godard de 1963 avec Brigitte Bardot, Michel Piccoli, Jack Palance, Fritz Lang, Georgia Moll, Jean-Luc Godard, chef d’œuvre des années 1960. D’après le roman de Moravia que Godard qualifiait de « roman de gare« , le film traite de l’un des thèmes favoris de l’écrivain, l’incommunicabilité entre les êtres. Un auteur de pièces de théâtre en panne d’inspiration accepte un travail alimentaire pour acheter un appartement qui plaît à sa femme. Celle-ci s’imagine que son mari, pour être assuré d’obtenir son contrat, la jette sciemment dans les bras du producteur américain qui veut réaliser une nouvelle version de l’Odyssée réalisée par Fritz Lang qui joue son propre rôle. Pour cette raison, elle se met à mépriser son mari.
Le mépris. Drame de Jean-Luc Godard de 1963 avec Brigitte Bardot, Michel Piccoli, Jack Palance, Fritz Lang, Georgia Moll, Jean-Luc Godard, chef d’œuvre des années 1960. D’après le roman de Moravia que Godard qualifiait de « roman de gare« , le film traite de l’un des thèmes favoris de l’écrivain, l’incommunicabilité entre les êtres. Un auteur de pièces de théâtre en panne d’inspiration accepte un travail alimentaire pour acheter un appartement qui plaît à sa femme. Celle-ci s’imagine que son mari, pour être assuré d’obtenir son contrat, la jette sciemment dans les bras du producteur américain qui veut réaliser une nouvelle version de l’Odyssée réalisée par Fritz Lang qui joue son propre rôle. Pour cette raison, elle se met à mépriser son mari.
Hier, aujourd’hui, demain. Film à sketches de Vittorio De Sica de 1964 avec Sophia Loren et Marcello Mastroiani, ayant mis à contribution six scénaristes, dont Moravia.
L’ennui. Drame de Damiano Damiani de 1964, d’après « La Noia » de Moravia. Avec Horst Buchholz, Catherine Spaak, Bette Davis et Isa Miranda. Peintre raté, Dino voudrait posséder à la fois son modèle et la réalité. Film moraliste sur le thème de l’amour impossible pour une réalité qui se dérobe sans cesse. Ce film a fait l’objet d’un « remake » en 1998.
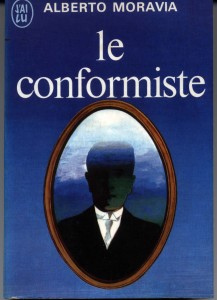 Le conformiste. Drame de Bernardo Bertolucci de 1970, d’après le roman éponyme de Moravia, avec Jean-Louis Trintignant, Dominique Sanda, Stefania Sandrelli, Pierre Clémenti et Gastone Moschin. Un chef d’œuvre de Bernardo Bertolucci, excellemment servi par de très grands acteurs, qui illustrent à merveille le propos du roman de Moravia. Il nous montre de l’intérieur ce qu’est le fascisme et ce qu’est un fasciste : celui qui, complexé, ayant souffert de l’indifférence de ses parents appartenant à la haute bourgeoisie, qui a découvert chez lui l’empire de pulsions violentes, puis fait un mauvais mariage, n’a de cesse que de se prouver qu’il est normal, qu’il est conforme aux normes sociales du moment. C’est pourquoi il s’engage dans le mouvement fasciste, dans ses services secrets. Il obéit à ses chefs sans s’interroger sur la nature de la mission qui lui est confiée. Elle consiste à participer à l’élimination d’un opposant en exil à Paris qui n’est autre que son ancien professeur de philosophie à l’Université. Le conformiste ne s’indigne pas non plus des dérives qu’il peut observer parmi la nouvelle « nomenklatura » que constitue, faute de contre-pouvoirs et faute du sens des convenances, les dirigeants du mouvement fasciste. Conformisme = indifférence = complaisance.
Le conformiste. Drame de Bernardo Bertolucci de 1970, d’après le roman éponyme de Moravia, avec Jean-Louis Trintignant, Dominique Sanda, Stefania Sandrelli, Pierre Clémenti et Gastone Moschin. Un chef d’œuvre de Bernardo Bertolucci, excellemment servi par de très grands acteurs, qui illustrent à merveille le propos du roman de Moravia. Il nous montre de l’intérieur ce qu’est le fascisme et ce qu’est un fasciste : celui qui, complexé, ayant souffert de l’indifférence de ses parents appartenant à la haute bourgeoisie, qui a découvert chez lui l’empire de pulsions violentes, puis fait un mauvais mariage, n’a de cesse que de se prouver qu’il est normal, qu’il est conforme aux normes sociales du moment. C’est pourquoi il s’engage dans le mouvement fasciste, dans ses services secrets. Il obéit à ses chefs sans s’interroger sur la nature de la mission qui lui est confiée. Elle consiste à participer à l’élimination d’un opposant en exil à Paris qui n’est autre que son ancien professeur de philosophie à l’Université. Le conformiste ne s’indigne pas non plus des dérives qu’il peut observer parmi la nouvelle « nomenklatura » que constitue, faute de contre-pouvoirs et faute du sens des convenances, les dirigeants du mouvement fasciste. Conformisme = indifférence = complaisance.
L’ignorance, le futile et le clinquant
Au cours de ses voyages, pendant et après la crise de 1968 (2), Moravia avait vu la jeunesse des pays économiquement avancés se révolter contre la société de consommation et dénoncer les gouvernants incapables de résoudre les problèmes du monde, à cette époque la guerre froide et la menace nucléaire. Moravia reconnaissait aussi que la consommation pour la consommation n’apporte pas le progrès. A propos de la République Populaire de Chine, Moravia avait très bien compris les raisons du déclenchement de la révolution culturelle, voulue par Mao Tse Toung, dans le but conserver et d’affirmer son pouvoir.
Certes, depuis cette date, le monde a changé. Aujourd’hui en ce début de XXIe siècle, d’autres problèmes se posent. Mais face à ces nouveaux problèmes, ce qui prévaut, en France tout particulièrement, c’est plutôt l’individualisme, le repli sur soi, l’indifférence, l’abstention, voire le mépris de la vie politique. Cette attitude, notamment chez les jeunes générations, provient de l’indifférence pour la lecture, résulte du manque de goût pour la littérature. Cette inculture conduit à l’ignorance du passé, au rejet des valeurs fondamentales, à l’ignorance des invariants de la vie en société, au goût trop exclusif pour le divertissement, le futile, le clinquant, le superficiel. Il est vrai qu’en matière de média, abondance de biens peut nuire.
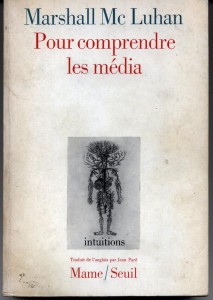 « Le message, c’est le média«
« Le message, c’est le média«
Le psychosociologue canadien Marshall Mc Luhan a publié cette formule en 1960 dans un livre prémonitoire intitulé « Pour comprendre les média« . Prémonitoire, car au moment des premiers développements du réseau Internet, il avait compris qu’allait se former un « village mondial« . Dans son livre, il montrait que l’apparition d’un nouveau média, Internet en l’occurrence pour nous, alors que pour Mc Luhan c’était la télévision, n’anéantit pas les media précédents, mais qu’il les absorbe et les transforme en une forme d’art.
Demain, nous disposerons d’un écran nomade à tout faire. Il absorbera Internet, le média régnant actuellement. Nous pourrons consulter des sites, notre messagerie, regarder la télévision, des vidéo, des images, écouter la radio, de la musique, des conférences, lire des livres numérisés, enregistrer et transmettre nos paroles, c’est-à-dire notre pensée. Le message sera le fait de posséder cet outil. Il signifiera que nous sommes modernes, disponibles, branchés ! Mais pour comprendre et assimiler les contenus de ce nouvel outil, pour communiquer de façon efficace avec les autres, sur le plan personnel aussi bien que sur le plan professionnel, il faudra faire des efforts accrus de culture générale. De la même façon que, pour apprécier les œuvres d’art, il faut avoir reçu une éducation. Pour admirer avec profit l’œuvre d’un artiste dans un musée, mieux vaut avoir préparé sa visite.
L’histoire est tragique
Tout de même, quel parcours que celui d’Alberto Moravia ! Quel bel exemple de l’utilité de la lecture pour réussir sa vie !
Né en 1907, le futur écrivain avait sept ans au moment du déclenchement de la première guerre mondiale. À cet âge-là, son esprit a pu conserver les premiers souvenirs, les premières sensations d’un fait historique majeur, la déclaration de la guerre, une guerre que l’on espérait courte, fraiche et joyeuse, la fleur au fusil… En fait, ce sera un conflit mondial de quatre ans qui aura marqué un XXe siècle tragique, que Moravia s’attachera à décrire toute sa vie. Car la guerre de 1914-1918 aura eu pour conséquence la fin du régime tsariste en Russie et la mise en place du communisme, c’est à dire l’utopie de la création d’un homme nouveau destiné à vivre dans un paradis sur cette terre. Ensuite, le premier conflit mondial, cette catastrophe humaine, suscitera le fascisme en Italie et la tyrannie nazie en Allemagne. Moravia vivra pendant la montée en puissance de ces deux totalitarismes, puis il verra la chute du nazisme et du fascisme italien en 1945, puis la guerre froide entre les deux blocs, l’URSS et les USA. Car ce sont les français et les anglais, alliés contre les allemands, qui ont fait appel aux troupes américaines pour la première fois en 1917 et qui ont ainsi éveillé ce qui deviendra le géant technologique, économique et politique que nous connaissons. Au moment de sa mort en 1990, Alberto Moravia aura été le témoin de la chute du mur de Berlin. Un événement qui annonçait la fin de l’Union soviétique. La disparition imprévue et impréparée des idéologies criminelles du XXe siècle s’est traduit par un vide périlleux et par un bouleversement économique et politique mondial, dont nous ne savons pas exploiter avantageusement les conséquences.
De nos jours, on pourrait sans doute aller sur la lune rien qu’en escaladant le tas formé par les ouvrages, livres, essais, rapports, articles, publiés depuis cinquante ans et qui étudient les changements politiques, économiques et sociaux. D’innombrables intellectuels ont fait et font encore des diagnostics pertinents, proposent des solutions élégantes et… rien ne se passe. Ou si peu, ou si mal !
Parce que ces experts, ces intellectuels restent dans le domaine de l’abstraction, des mots, donc du malentendu. L’échec s’explique parce que nous essayons de construire notre avenir sans tenir compte des leçons du passé et avec la nostalgie d’une Histoire, un lieu d’affrontement du Bien et du Mal dont nous ne souhaitons garder en mémoire que les aspects positifs.
Pourtant, pour reprendre la formule d’André Malraux, nous avons besoin d’acteurs politiques, économiques et sociaux en qui s’unissent l’aptitude à l’action, la culture et la lucidité. Le personnage principal du roman « Le conformiste » et l’œuvre toute entière d’Alberto Moravia restent encore aujourd’hui d’une confondante actualité.
Où est l’homme ? Où est l’humanisme ? Où est le mérite ? Où est la confiance en notre capacité d’agir dans la dignité ?
Une vertu bien oubliée est à redécouvrir d’urgence. Elle s’appelle l’altruisme.
À bon lecteur, salut !
Bernard Labauge
(1) – Référence au chef d’œuvre cinématographique de Jean Renoir, chahuté à sa sortie au cinéma Le Colisée à Paris en juill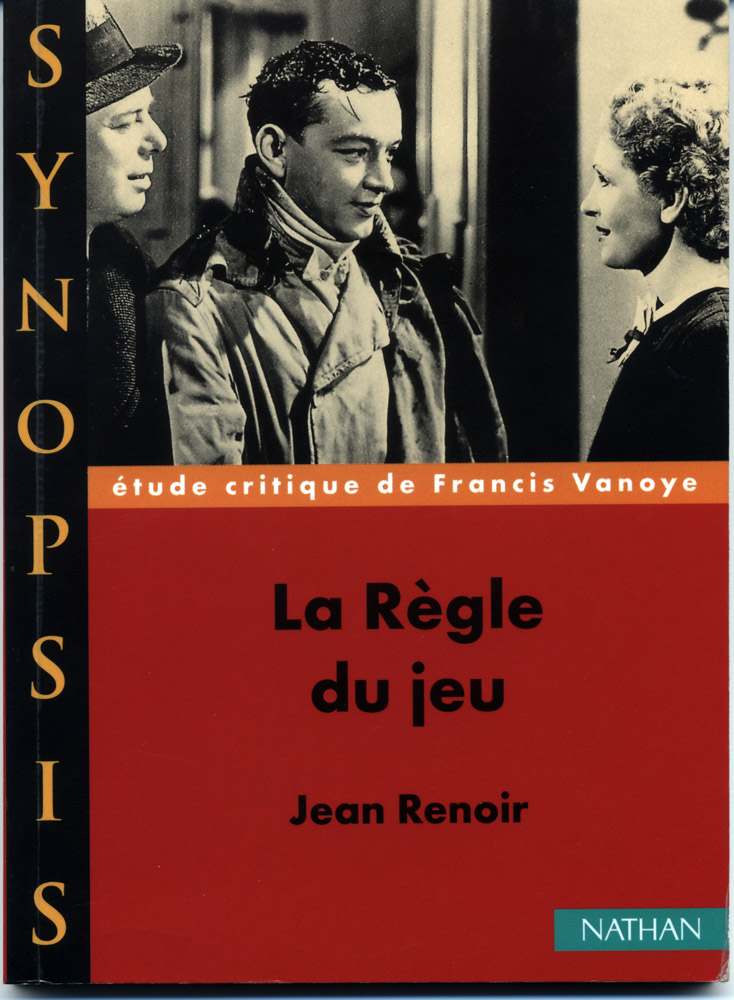 et 1939. Il ne deviendra un film culte qu’en 1965, lorsqu’une nouvelle génération de jeunes français décidera de secouer le cocotier d’une France restée archaïque (Cf. H. Mendras. La seconde révolution française : 1965-1984). Le film montre une société en décomposition à la veille d’un deuxième conflit mondial qui allait achever de détruire la civilisation européenne occidentale. La règle du jeu, c’est le jeu social, le théâtre social ou aristocrates et grands bourgeois s’attachent à conserver leurs dérisoires privilèges. Comme dans les romans de Moravia, leurs préoccupations vont essentiellement à l’argent et au sexe, tandis que les pauvres, les domestiques, imitent les comportements et les préjugés de leurs maîtres, avec égoïsme et hypocrisie, dans le contexte d’un antisémitisme qui était, à l’époque, d’une virulence inimaginable ajourd’hui.
et 1939. Il ne deviendra un film culte qu’en 1965, lorsqu’une nouvelle génération de jeunes français décidera de secouer le cocotier d’une France restée archaïque (Cf. H. Mendras. La seconde révolution française : 1965-1984). Le film montre une société en décomposition à la veille d’un deuxième conflit mondial qui allait achever de détruire la civilisation européenne occidentale. La règle du jeu, c’est le jeu social, le théâtre social ou aristocrates et grands bourgeois s’attachent à conserver leurs dérisoires privilèges. Comme dans les romans de Moravia, leurs préoccupations vont essentiellement à l’argent et au sexe, tandis que les pauvres, les domestiques, imitent les comportements et les préjugés de leurs maîtres, avec égoïsme et hypocrisie, dans le contexte d’un antisémitisme qui était, à l’époque, d’une virulence inimaginable ajourd’hui.
(2) – Consulter la remarquable interview d’Alberto Moravia réalisée en 1968 par Radio Canada :
http://archives.radio-canada.ca/arts_culture/litterature/clips/13804/.
Autres sites suggérés :
- Sur Wikipedia consulter la biographie des personnages cités ci-dessus,
- sur France Culture, l’émision « Les mercredis du théâtre », le 16 décembre 2009, consacrée à Dostoïevski : http://sites.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/mercredis-du-theatre/fiche.php?diffusion_id=78898
- et des extraits des films tirés des romans de Moravia sur YouTube.